TONI MORRISON : « Les racistes sont une minorité face à tous les pauvres, toutes les femmes et tous les Noirs »
En ce début d’année 2021, l’ASCODELA remet le bleu de chauffe, avec un retour sur notre soirée spéciale Toni Morrison, décédée le 5 août 2019 à l’âge de 88 ans, prix Nobel de littérature en 1993, et première femme afro-américaine à avoir reçu cette distinction. « Les personnes racistes tentent toujours de vous faire croire qu’ils sont la majorité, mais ils ne le sont jamais. Ils sont une minorité face à tous les pauvres, toutes les femmes et tous les Noirs ». River Styx.
On ne pourrait extraire l’œuvre de Toni Morrison de sa spatialisation afro-américaine, du lien traumatique noué avec l’Amérique, de cette population d’esclaves qui semblait s’offrir comme objet de méditation sur les leurres et le caractère insaisissable de la liberté humaine. Comme l’a remarqué Orlando Patterson, sociologue américain, nous ne devrions pas nous étonner que les Lumières aient pu faire une place à l’esclavage : c’est l’inverse qui devrait nous étonner. Le concept d’«africanisme » a permis de soulager les peurs intérieures et de rationaliser l’exploitation extérieure : un mélange inventé de noirceur, d’altérité, d’inquiétude et de désir, et juxtaposés à l’agression interne, le mal, le péché, l’avidité, une Nature sans limites, la solitude innée, «un nouvel homme Blanc», éprouvant en lui-même un sentiment d’autorité et d’autonomie inconnu auparavant, une force découlant de son contrôle absolu sur la vie des autres, dans un monde brut, à moitié «sauvage ».
La source de l’amour-propre (Ed. Christian Bourgeois, traduction de Christine Laferrière) paru le 3 octobre 2019, réunit quarante-trois textes, conférences ou discours, dans lesquels l’écrivaine abordait de multiples questions, tant sociales que politiques, artistiques ou morales.
Divisés en trois parties intitulées «La patrie de l’étranger», «Interlude Black Matter(s)», et «Le langage de Dieu», ils regroupent les grands thèmes de prédilection de l’écrivain : la violence des préjugés, l’enfance meurtrie, la couleur, le racisme et la hiérarchisation, les représentations des Noirs, la pédophilie, les relations mère-fille, les littératures américaine et africaine.
Florence MOUTOU nous livrait une introduction magistrale et ébouriffante de l’œuvre complexe du prix Nobel. Jeanine PELER, à sa suite, subjuguait à son tour l’assistance, par son sens de la synthèse hors du commun, et entreprenait de déconstruire la double représentation mythique de Toni Morrison, écrivaine noire et féministe.
Si souffrance originelle et vision apologétique constituent de façon récurrente les deux paradigmes de la communauté afro-américaine, Toni Morrison loin de nous livrer des histoires archétypales, mythiques, classiques, s’est détournée des personnages héroïques de résistants et de rebelles qu’affectionnent les féministes et les nationalistes noirs. Son processus d’écriture concerne la complexité inhérente à la création d’un langage narratif à la fois évocateur d’un point de vue racial, et ne travestissant pas la sombre réalité.
Nos deux intervenantes se rejoignaient sur un point précis : l’œuvre du prix nobel se place du côté des plus faibles : les femmes, les enfants, et ceux que l’on rejette parce qu’ils représentent le tabou et l’abjection.
«De tous les personnages choisis pour être examinés d’un point de vue artistique, avec empathie ou mépris, les jeunes Noires vulnérables étaient grandement absentes. En revanche quand elles apparaissaient, elles fournissaient matière à plaisanterie ou des occasions de s’apitoyer : de s’apitoyer sans comprendre».
Elle indique avoir puisé à la source littéraire de James Baldwin, et s’adressant à lui : «Tu sais parler la langue qui nous dit ce que seule la langue peut dire : comment voir sans images ».
Elle considère qu’il a refaçonné l’anglais américain, jusqu’à ce qu’il soit vraiment moderne, dialogique, représentatif, humain. Elle a comme pénétré dans ce territoire interdit, « Tu m’as offert la langue dans laquelle résider.
C’est toi (poursuit-elle), qui nous a donné le courage de nous approprier une géographie étrangère, hostile, totalement blanche, parce que tu avais découvert que ce monde n’est plus blanc et il ne le sera plus jamais ».
La blancheur du cachalot
Le lien entre l’esclavage américain et la liberté américaine, s’épanouit dans l’œuvre maîtresse de Melville.
Dans « Moby Dick », ( 1851), Achab, capitaine d’une baleinière, doit anéantir un cachalot blanc. Toni Morrison discerne le chapitre 42 la blancheur du cachalot. «Le cachalot blanc est l’idéologie de la race, ce qu’il a coûté à Achab, c’est son démembrement personnel, sa famille, sa société, et sa propre place en tant qu’être humain dans le monde, la sévère fragmentation du moi ».
La mer représente le chaos, la violence (par la conquête, la chasse au cachalot, le vaisseau négrier), mais aussi l’immobilité (recherches et méditations métaphysiques, vigies inutiles à bord).
Tous ces écrivains disposaient d’un élément supplémentaire pour méditer sur le chaos. La Nature, l’Ouest vierge, l’espace, la proximité de la mort.
«Cependant c’était la disponibilité d’un chaos domestique, d’un désordre inventé, d’un Autre présumé non civilisé, sauvage, éternel et intemporel, qui confère à l’Histoire américaine sa formulation spéciale. Cet Autre, c’est la présence africaniste».
Le monde visible (des couleurs) semble avoir été créé dans l’amour, les sphères invisibles (blanches), elles, l’ont été dans l’épouvante.
Toni Morrison nous éloigne toutefois de toute spéculation sur une supposée philanthropie de Melville. Ce dernier n’était pas engagé dans un didactique noir/blanc, simplet, ni ne diabolisait les Blancs. Il était simplement submergé par les incohérences philosophiques et métaphysiques d’une idée extraordinaire et sans précédent.
Une race d’individus a été déclarée criminelle
Oui, toute une race d’individus a été déclarée criminelle, signalée d’emblée par la couleur de la peau. «Je n’ai jamais vécu, ni aucun d’entre vous, dans un monde où la race n’importait pas », nous lance Toni Morrison.
Les justifications de l’asservissement deviennent à toutes les époques une sagesse commune.
Un professeur blanc a pu demander à Web Dubois, le célèbre historien, et militant pour les droits civiques, «si un nègre versait des larmes».
Toni Morrison égrène, un florilège de perles maudites, propos d’illustres fondateurs des U.S.A.
Benjamin Franklin en 1751 : « Pourquoi multiplier les fils de l’Afrique en les implantant en Amérique, où nous avons une si belle situation, -en excluant tous les Noirs et tous les basanés-, de multiplier les charmants Blancs et Rouges ? ».
Andrew Jackson, septième président des Etats-Unis, 1833 : « Les Noirs n’ont ni l’intelligence, l’application, les habitudes morales, ni le désir de s’améliorer qui sont indispensables à tout changement favorable de leur condition. Etablis au milieu d’une race autre et supérieure, et sans apprécier les causes de leur infériorité ni chercher à les maîtriser, ils doivent nécessairement céder à la force des circonstances et disparaître sous peu ».
Le New-York Tribune de 1854 : « Les Chinois sont non civilisés, impurs et crasseux au-delà de tout ce que l’on peut imaginer, sans relations domestiques ni sociales élevées ; lascifs et sensuels de tempéraments ; et chaque femme est une prostituée de dernier ordre ».
Théodore Roosevelt, vingt-sixième président des Etats-Unis, en 1901 : «Je m’accorde entièrement avec vous pour dire qu’en tant que race et dans leur ensemble, les Noirs sont tout à fait inférieurs aux blancs. Je suppose que je devrais avoir honte de dire que j’adopte l’opinion qu’à l’Occident de l’Indien. Je ne vais pas jusqu’à penser que les seuls bons indiens sont les Indiens morts, mais je crois que cela vaut pour neuf indiens sur dix et je n’aimerais pas examiner de trop près le cas du dixième ».
Avec un tel passé, et ajouterons-nous un tel présent – nous ne pouvons pas être optimistes quant à la réalisation d’une société vraiment humaine, nous ne pouvons qu’être lucides. La contemplation d’un tel avenir a provoqué les tremblements des prophètes des derniers jours, les irruptions aléatoires d’armageddonisme et les désirs permanents d’apocalypse.
Oui, notre héritage est un affront. Notre passé est sinistre, «qui ronge l’avenir et qui gonfle en avançant» selon la formule d’Henri Bergson.
Comment Toni Morrison aurait-elle pu échapper dans ses divers romans, à l’exploration de sujets non infléchis et encombrés par la race ?
La race peut être mortelle
Un des dilemmes maintes fois exprimés par l’écrivain, consiste toutefois à exprimer la race tout en la privant de son emprise mortelle.
Depuis l’origine de l’humanité, tous les conquérants ont laissé le sol étranger maculé de leur sang et/ou ont transféré leur sang dans les veines des conquis.
Et plus que jamais de nos jours, toute différence est désormais une effrayante altérité. Le mal serait-il manifestement inintelligible, gratuit et indéchiffrable ? La société contemporaine n’est pas à l’aise face au concept de mal pur, sans motif.
La plupart des individus s’associent en complices au processus d’aliénation, à l’intérieur de leurs propres familles, – par des pratiques qui encouragent l’auto-dévalorisation-, ou de diabolisation des autres en rejetant d’autres communautés. Les immigrants, ou leurs enfants sont relégués à une version moderne des morts-vivants. Dans le pays le plus puissant du monde, un gouvernement ne s’est-il pas contenté de regarder un déluge presque biblique inonder une ville, parce que ses habitants étaient noirs et pauvres ?
Alors qu’il est de bon ton de saluer un nouveau cosmopolitisme, un genre de citoyenneté culturelle mondialisée à niveaux multiples, des peuples sont confrontés à un apartheid culturel, ou en montant de plusieurs degrés dans l’horreur balkanisée, à la purification ethnique. C’est le destin tragique auquel sont actuellement confrontés des millions de personnes réduites au statut d’animal, d’insecte ou de polluant par des nations s’arrogeant le pouvoir moral et impénitent de décider qui est étranger, et qui doit vivre ou mourir.
Les guerres raciales cataclysmiques sont légion, et les Dieux-prétextes viennent à la rescousse des tueurs.
Notre monde moderne a hérité d’un appareil complet de persécution et d’une tradition intellectuelle qui justifiait de tuer au nom de Dieu.
Les nations et pseudo-états, à mesure qu’ils forment leurs élèves à purger, affirment des pouvoirs à faire pâlir Caligula, sous couvert de nationalisme.
Nul n’est innocent ou indemne
De «The Bluest Eye» (L’Oeil le plus beau), son premier roman, où au début des années quarante, une jeune fille noire, Pecola, auprès d’un père incestueux et alcoolique prie chaque nuit pour avoir les yeux bleus de Shirley TEMPLE, à «Beloved », récompensé par le prix Pulitzer, dans lequel l’héroïne ayant égorgé sa fille par amour, voit ce fantôme du passé ressurgir sous les traits d’une adolescente mystérieuse, avec une cicatrice lui barrant le cou, aucun personnage des romans de Toni Morrison n’est innocent ou indemne. Si l’exhumation de l’horreur et de la folie d’un passé douloureux, et le tragique destin de millions de femmes esclaves et mères, à qui l’on a ôté le droit d’aimer leur propre chair sont contrebalancés par le réalisme magique de Beloved, il n’en reste pas moins que prédomine le lien malsain qui unit la mère Sethe, coupable d’infanticide, et le petit être réincarné.
Selon Michel FABRE «les rapports entre mère et fille sont inaccomplis et tragiques. Le retour de Beloved ne les résout que brièvement. L’amour éperdu « tue », et l’acte sacrificiel, incompris de la communauté l’est encore plus de la victime».
«L’acte créateur n’est pas pur… L’écrivain perd l’Eden, écrit pour être lu et découvre qu’il est tenu de répondre». Dans « Ecrire l’inceste en contre-fiction et en paradoxes : The Bluest Eye de Toni Morrison, Tina Harpin plaçait en exergue cette citation de Nadine Gordimer, et insistait sur le fait qu’alors que résonnaient les slogans du nationalisme noir, l’inceste qui est central dans l’œuvre, ne se reflète pas dans le titre, qui évoque plutôt l’aliénation, et donnait à voir pour la première fois le crime tabou réalisé dans une famille noire.
Les paradoxes de l’écriture du roman de Toni Morrison, la variation des points de vue et l’inscription d’un double silence (celui du personnage de Pecola, et celui de l’auteure), ont suscité l’émoi et l’incompréhension du plus grand nombre. Cette focalisation a choqué.
Pecola devient un vide narratif. Abandonné à sa naissance, dans une poubelle par sa mère, son père Cholly rentre ivre chez lui.
Pecola qu’il aura violée, enceinte de lui, cible de haine raciste et du rejet maternel, rejetée de tous, hantera la ville comme un fantôme, et tournera autour du dépôt d’ordures.
Pour décrire l’horreur de la situation, des mots tout autant insoutenables, sont utilisés, pour expliciter le viol, faisant référence à une transmission d’âmes. «Son âme a semblé glisser dans son ventre et jaillir en elle». Comme d’autres auteurs noirs, elle a opté pour le renversement et le détournement d’images. C’est rempli d’une sorte de pitié devant le désespoir et la vulnérabilité que sa fille lui renvoie, que Cholly «wanted to fuck her-tenderly».
La représentation frontale de l’inceste, voilé et dévoilé, inaugure ce mouvement réflexif qui interroge d’une autre façon les limites de la communauté, et sa complicité dans la destruction de Pecola, selon plusieurs critiques littéraires.
Indirectement, est souligné, selon ces mêmes critiques, le fait que Toni Morrison met en évidence l’importance du regard du père sur sa fille, véritable credo de la culture américaine «blanche», et cet apparent conformisme aurait une valeur subversive double. Nous pouvons estimer qu’à l’heure où l’on parle d’appropriation culturelle d’une façon négative, elle indiquerait par là même, se conformer aux valeurs décriées de l’arrogante puissance yankee, et/ou du monde occidental, qui valoriseraient les filles.
Les mots qu’elle emploie pour témoigner de l’amour entre les êtres, et de leurs limites, sont eux-aussi universels. «L’amour ne vaut jamais mieux que celui qui aime. Les gens méchants aiment méchamment, les gens violents aiment violemment, les gens faibles aiment faiblement, les gens bêtes aiment bêtement, mais l’amour d’un homme libre n’est jamais sûr».
Les limites des représentations culturelles
La culture que nous tenons pour essentielle, est galvaudée, peut-être anéantie, car entre les mains des puissances d’argent. «Quand nos peurs auront toutes été adaptées en feuilletons ; notre créativité, censurée ; nos idées, « mises sur le marché » ; nos droits, vendus ; notre intelligence, transformée en slogans ; notre force, diminuée ; notre intimité, vendue aux enchères ; quand la théâtralité, la valeur de divertissement et la commercialisation de la vie seront complètes, nous nous retrouverons à vivre non dans une nation, mais dans un consortium d’industries, entièrement inintelligibles à nous-même, exception faite de ce que nous verrons vaguement comme derrière un écran».
La presse, tend à devenir également un monde de spectacle en circuit fermé, qui n’a d’autre objectif que son moi spectaculaire, un éphémère éternel et éternellement réapprovisionné.
Dans « Trois vies » de Gertrude Stein (1909), la brave Anna, la douce Léna, encadrent Mélanchta. Ces trois femmes sont toutes domestiques. Toutes sont maltraitées par les hommes ou par les conséquences d’une société dominée par les hommes. Anna et Léa sont deux femmes blanches de nationalité allemande. Mélancta est une noire (ou ainsi que Stein la définit, une négresse).
Son amie, «La noire Rosie, maussade, enfantine et lâche, grognait et faisait des histoires et hurlait et se rendait abominable et pareille à une simple bête». Dans cette série d’adjectifs se trouvent toutes les obsessions, toutes les formes de réduction métonymique, toute la dégradation des personnes en animaux afin d’empêcher le dialogue, l’identification, et la création de stéréotypes économiques, tous omniprésents dans les sous-entendus.
L’africanisme de cette paria devient un moyen par lequel Stein peut pénétrer sans risque en territoire interdit, exprimer ce qui est illégal et anarchique, méditer sur les relations homme-femme. Gertrude Stein est à l’aise en promouvant sa nouveauté, elle opère sur un corps qui lui semble offert sans protestation, sans retenue.
En 1909, il était peut-être impensable, même pour Stein, de parler d’une connaissance explicite de l’acte de chair chez les femmes blanches, même celles appartenant à une classe inférieure.
Mais bien que ses présupposés soient traditionnellement racistes, par exemple Rose «avait cette immoralité simple de la promiscuité commune aux Noirs», Toni Morrison parle de remarquable contribution de Stein à la littérature, dans sa rencontre avec la présence africaniste, par le fait de donner à cette rencontre la complexité et la modernité que lui avaient refusées les écrivains dominants de son époque.
On peut d’ailleurs se demander si les codifications modernes de la couleur de peau ne seraient pas aussi stigmatisantes qu’au début du XXème siècle.
Toni Morrison prend comme exemple les contorsions que les journalistes font subir à la langue pour décrire les conséquences de la récente immigration de la population hispanophone de Miami sur sa population anglophone. Ainsi, dans un article sur l’immigration en Floride, un journaliste du New York Times, titrait : «La présence hispanique s’accroît, la colère des Noirs aussi». Elle nous livre ce constat amer. Sauf quand ce sont des militaires, les Noirs ne sont jamais des citoyens américains.
La formulation «Les Noirs», est un mot codé et communément accepté pour désigner les pauvres, ou les individus en marge, car nous dit-elle, nous pourrions supposer que des hispaniques sont aussi pauvres, sans emploi, sans logis. Les étiquettes qui apparaissent : «Cubains des deux couleurs, Noirs non hispaniques, Noirs anglophones nés dans ce pays, Noirs de Haïti et autres îles des Caraïbes», traduisent cette volonté de maintenir l’humain dans des catégorisations raciales indépassables.
Les conséquences de la mise en valeur de la race sont si déroutantes qu’elles ont amené un journaliste de CNN à se demander, non sans une profonde inquiétude, si l’on pouvait trouver un locuteur du haïtien pour aider un pilote haïtien ayant détourné un avion vers Miami. Le fait qu’il puisse maîtriser le français ne lui est jamais venu à l’idée.
Le traitement de la race est symptomatique d’ un codage systématisé afin de perpétuer des stéréotypes très anciens, par l’insistance et la mise en valeur de la différence raciale.
La fausse promesse d’un certain féminisme
La fausse promesse d’un certain féminisme est analysée avec brio. Jeanine PELER a tenu à souligner l’importance de ce discours que l’éditeur a intitulé : Les demi-sœurs de Cendrillon. Toni Morrison, féministe convaincue, se dit affolée par la violence que les femmes s’infligent entre elles : violence professionnelle, violence compétitive, violence affective, et par l’empressement des femmes à asservir d’autres femmes.
Nous connaissons les ingrédients, explique-t-elle, qui ont fait le succès du conte des frères Grimm, un père absent, assez vague, un prince fétichiste du pied qui arrive juste à temps, et des «mères» de substitution, belle-mère et marraine, qui contribuent tant au chagrin de Cendrillon qu’à sa libération et à son bonheur. Si on excepte la fée-marraine, nous avons un condensé de femmes rassemblées et unies afin de maltraiter une autre femme.
En effet, contrairement à ce que laissent penser les adaptations du conte de Grimm, les demi-sœurs de Cendrillon ne sont surtout pas des filles laides, maladroites, ni idiotes, aux pieds démesurés. Ce sont des femmes belles et élégantes, de condition élevée, et manifestement des femmes de pouvoir. Ces jeunes filles, ont grandi avec une mère qui asservissait une autre fille. Elles ont observé cette violente domination, et l’ont reproduite.
Les défis du mondialisme
Ce système a engendré le parfait capitaliste, un individu prêt à tuer un être humain pour obtenir un produit (une paire de baskets, un blouson, une voiture), ou à tuer plusieurs générations pour s’assurer le contrôle de divers produits (pétrole, médicaments, fruits, or).
L’aspect caméléon de l’économie mondiale, ne fait presque plus obstacle à l’effet Midas, au gène Gatsby.
Les sources de la création littéraire américaine
Comment supposer que la littérature américaine traditionnelle, canonique, n’ait pas été affectée, formée et façonnée par les quatre cents ans de présence d’abord des Africains, puis des Africains-Américains, et que la présence noire ne soit pas essentielle à toute compréhension de cette littérature ?
Comment l’énoncé littéraire s’organise-t-il lorsqu’il tente d’imaginer les signes, les codes, les stratagèmes littéraires conçus pour s’adapter à une telle rencontre ? Les écrivains américains parlent d’eux-mêmes par le biais et au sein d’une représentation tantôt allégorique, tantôt métaphorique, mais toujours étouffée, de la présence africaniste. Nous l’avons signalé avec Moby Dick.
Les controverses majeures sur la grandeur ou la quasi-grandeur de Huckleberry Finn se concentrent sur l’effondrement de la fin tragique du roman. La réserve apparemment illimitée d’amour et de compassion qu’a l’homme Noir pour ses maîtres blancs, ses présupposés voulant que les Blancs soient en effet ce qu’ils disent être : supérieurs et adultes, ce qui permet à ses persécuteurs de le tourmenter et de l’humilier, comme Jim est forcé de le faire, et qu’il réagit à ces tourments par un amour sans limites.
«L’humiliation que Tom et Huck font subir à Jim est baroque, infinie, idiote, abrutissante, et elle arrive après que nous avons connu Jim sous les traits d’un adulte, d’un père intentionné et d’un homme sensible. Mais ce qui devrait attirer notre attention, c’est que ce roman stimule et décrit la nature parasite de la liberté des blancs.
Ni Huck, ni Twain ne peuvent tolérer un Jim affranchi ».
La réponse de Toni Morrison à ceux qui évoquent une censure littéraire est définitive. «Et moi du moins je n’ai pas l’intention de vivre sans Eschyle, ni William Shakespeare, ni James, ni Hawthorne, ni Melville, etc… ».
« Tout s’effondre » pour le plus grand bonheur de Toni Morrison
Les «tropes» littéraires de l’Afrique sont des répliques exactes des perceptions de l’extranéité : menaçante, dépravée, inintelligible.
Toni Morrison pouvait alors souligner sa jubilation à la découverte que cette littérature ne se limitait pas à Doris Lessing et Joseph Conrad.
La publication de Contemporary African Literature, en 1972, pour cette ancienne éditrice, a marqué le début de cette histoire d’amour. Elle évoque l’influence des romans de Chinua Achebe sur ses propres débuts littéraires, suite à la lecture de « Transition ». Dans cet essai, Achebe citait les commentaires de James Baldwin sur le choix et la manipulation de la langue dans le processus de définition des littératures nationales et culturelles, et sur leur résonance parmi les écrivains marginalisés.
Les Tontons Macoutes
Qui pourrait oublier les années de dictature en Haïti, où les gangs gouvernementaux, les « Tontons macoutes » parcouraient l’île en tuant les dissidents, ainsi que les individus innocents, ordinaires ? Nul n’était autorisé à récupérer les morts gisant dans les rues, les parcs, ou dans l’embrasure des portes. Comble de l’horreur, si un frère, un parent, un enfant, s’aventurait à le faire, afin d’enterrer le mort et de l’honorer, il était lui-même abattu par balle. Les corps restaient là où ils étaient tombés jusqu’à ce qu’un camion d’éboueurs envoyé par le gouvernement arrive pour débarrasser les cadavres.
Ces instillations de terreur traumatique accentuaient le lien entre les ordures et l’humain dont on s’était débarrassé.
«Un professeur a alors réuni les habitants des quartiers, et leur a fait jouer le même spectacle tous les soirs. Quand un membre des tontons macoutes les observait, il ne voyait que des individus inoffensifs occupés à quelques effets théâtraux inoffensifs. Mais la pièce qu’ils jouaient était Antigone, tragédie antique sur les conséquences morales et fatales dues au fait de déshonorer les morts en ne les ensevelissant pas».
Oui, seule la langue nous protège de la nature effroyable des choses sans nom. Mais la langue ne peut jamais fixer l’esclavage, le génocide, la guerre. Elle ne doit pas non plus aspirer à l’arrogance d’en être capable. Sa force et sa félicité résident dans son mouvement vers l’ineffable.
Le philosophe Geoffroy de Lagasnerie affirmait que «les gens savent la vérité du monde. Ils savent qu’il y a de la domination, savent qu’il y a de l’exploitation, savent qu’il y a de la misère, mais ils s’inventent des discours pour ne pas les voir, pour continuer à perpétuer l’ordre et faire sa vie avec bonne conscience».
Toni Morrison, elle, sait la vérité du monde, mais n’invente pas de discours. Elle nous a juste apporté la confirmation que la littérature peut servir à ne pas succomber au suicide langagier de ceux qui se sont sectionné la langue d’un coup de dents, et qui utilisent des balles d’armes à feu pour réitérer le vide de l’absence de paroles.
Elle nous laisse aussi espérer un avenir qui sera façonné non seulement par ceux que l’on a rejetés comme surplus insignifiant, mais aussi par ceux que l’on a enveloppés de la cape du démon.
Daniel CORADIN












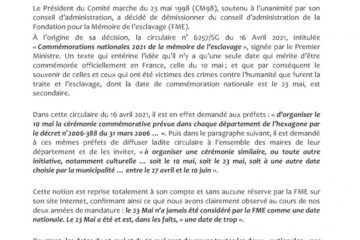


No Comment